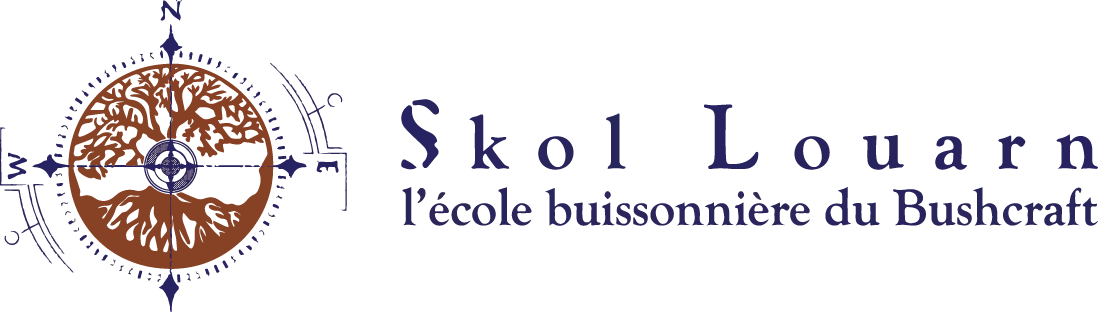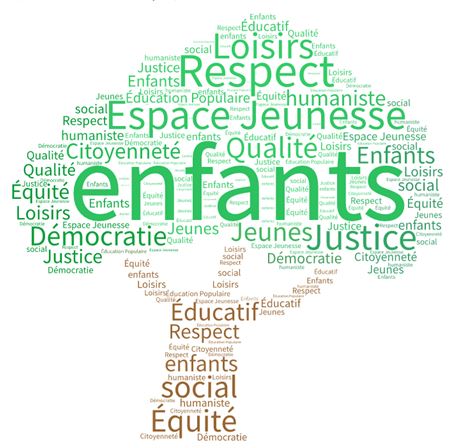Bien que nous ne soyons pas un ACM mais plutôt un prestataire intervenant au sein des ACM, nous avons depuis longtemps émis le souhait de présenter notre ambition éducative. Cela a une influence sur nos objectifs, nos méthodologies, notre manière de gérer vos projets, le comportement de notre intervenant à vos côtés.
PROJET ÉDUCATIF
Le but du projet éducatif est de traduire l’engagement de la structure, ses priorités, ses principes, les valeurs qu’il défend et prétend transmettre au public accueilli. Il permettra à tous de prendre connaissance de notre identité éducative.
Notre structure est une micro-entreprise bretonne, basée en région rennaise et intervenant sur tout le 35 pour les projets récurrents, sur toute la Bretagne pour les projets ponctuels, à 3h de voiture de Rennes maximum pour les projets occasionnels.
Notre vocation est de favoriser le retour du public dans une saine pratique de la nature, en conscience de l’impact humain sur l’environnement mais dans les deux sens : si on y va on peut modifier cet environnement donc soyons prudents ; mais aussi si nous cessons d’y aller pour des raisons de protection liées à une méconnaissance totale du terrain, un jour il n’y aura plus personne pour protéger la nature (puisque plus personne ayant un intérêt à y aller).
Dans le cadre de cette vocation, nos activités peuvent être prises comme des modules complémentaires au programme de l’éducation nationale ; mais aussi comme une activité extra-scolaire classique (si un groupe de parents porte un souhait de développer une forest school, on peut en parler) ; ou simplement comme une activité familiale, d’entreprise, d’association afin d’utiliser la nature comme un vecteur d’apprentissage, de fun ou de cohésion d’une équipe.
Notre méthode éducative sera essentiellement centrée sur le jeu quand c’est possible, sinon vers des échanges interactifs quand il le faudra. Parfois, il faudra peut-être lire un tableau ou écouter une mise en garde ou une méthodologie détaillée et pour cela il faudra écouter quelques minutes, nous pensons toutefois que le public en est capable. Ainsi nous valoriserons le jeu, l’aventure, le projet, selon les âges et les capacités ; cela permettra de se confronter au monde réel, à un monde de nature où l’autre existe (humain) et où chacun a une place (humains, animaux, végétaux). Cette méthodologie sera composée, dans ses sources pédagogiques et fondamentales, de plusieurs univers qui nous tiennent à coeur : le milieu scolaire, le milieu scout, le milieu sportif, le milieu associatif, le milieu naturel évidemment, mais aussi le milieu militaire qui apporte son lot de savoirs être et savoirs faire bienvenus à la vie de groupe en nature.
Nos influences s’inscriront en conformité autant que possible, avec les projets d’autres structures comme le REEB, la FNE, la LPO, les CPN, la ville de Rennes (projet PLEN’R). Nous travaillons tous avec comme finalité la protection de la nature, la pratique consciente et respectueuse de l’environnement (y aller, mais pas n’importe quand, pas n’importe comment).
1- Préambule sur les fonctions et aptitudes de notre intervenant
Notre intervenant (Renan) étant également formateur BAFA / BAFD depuis +15 ans, la Skol Louarn s’inscrit forcément dans une continuité avec les 5 fonctions les 4 aptitudes d’un animateur, qui sont donc les bases comportementales attendues pour notre intervenant.
Les cinq fonctions:
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogiques, aux risques liés, selon les circonstances, aux conduites addictives ou aux comportements à risque, notamment ceux liés à la sexualité ;
- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
- Participer à l‘accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ;
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités (pour nous, ça sera « les activités« ) ;
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Les quatre aptitudes:
- De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ;
- De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- De construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ;
- D’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.
2- Les valeurs que nous souhaitons développer (orientations)
a] Ralentir la cadence
Bien consciente que nous vivons désormais dans « le futur », une époque de connectivité élevée, de moyens de communications rapides et omniprésents, de facilité technologique incroyable à base de « 3 clics et c’est acheté » ou « 3 clics et c’est livré », la Skol Louarn souhaite s’engager à ralentir la cadence, pour les petits comme les grands. Propager les bienfaits de la Slow Life (la vie au rythme de l’humain, pas au rythme des grandes villes) sera donc notre priorité de manière générale. S’il faut prendre 1h30 pour allumer un feu, faire bouillir de l’eau, casser des grains de café entre deux pierres, récupérer la précieuse poudre, attendre qu’elle fonde dans l’eau chaude, et pourquoi pas ? Il n’y a pas de raccourcis nécessaires pour vivre, il suffit de prendre le temps.
b] Observer et protéger la nature
On arrache les mauvaises herbes, on piétine l’herbe des parcs, on coupe les branches d’arbres qui gênent, on cueille tout ce qui traîne, on met des coups de bâtons dans les fourrés, on tue les insectes qui montent sur nous, on crie quand on les voit, on a peur de ce qui bouge. A la Skol Louarn on a de longue date conclut que les gens, à juste titre si on se fie à notre évolution naturelle, ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. La peur mène au côté obscur à la panique, la panique mène à la violence et au rejet, à la discrimination.
Nous souhaitons donc resituer l’humain dans un contexte naturel afin qu’il se souvienne des connexions qu’il partage avec le vivant qui nous entoure. On peut pousser un insecte qui nous embête, le placer sur une branche haute à l’écart, on peut éviter des piétiner un massif de fleurs, on peut accrocher une branche pour l’orienter ailleurs sans la couper (parfois non, certes), on peut ne pas toucher un animal sauvage et se renseigner avant d’agir pour éviter de mal faire. On peut faire plus, on peut faire mieux. En observant la nature, on apprend à mieux la connaître, on s’en rapproche, on n’a moins peur, on devient tolérant face au vivant.
c] Rendre la nature accessible au plus grand nombre
Il est utopique de dire « à tous ». Certains ne veulent pas y aller, certains n’auront pas de temps à lui accorder, certains pour des raisons physiques ou mentales ne pourraient pas être accueillis en sécurité, c’est vrai. Pour les autres, rendons possible un accès adapté au besoin de chaque public. Comme par exemple : https://www.skol-louarn.com/2020/11/29/fous-lcamp-nouveau-programme-de-la-skol-louarn/ ou /https://www.skol-louarn.com/2020/12/12/un-nouveau-programme-destine-aux-personnes-en-situation-de-handicap/ . Il faudra pour cela se montrer ouvert et adaptatif, mais avec du temps, des réunions et des explications des envies et besoins, il nous semble fondamental de proposer au plus grand nombre une opportunité d’y aller pour de vrai.
d] Faire, faire, faire
C’est en bushcraftant qu’on devient bushcrafteur après tout. Nous croyons fermement que c’est en pratiquant la nature abondamment que les petits comme les grands parviendront à se souvenir de cette tante éloignée qu’on visite un peu moins depuis quelques années. Elle gagne à être connue, il est prouvé scientifiquement que des contacts courts ou longs, mais réguliers dans la nature permettent de baisser le taux de stress, d’équilibrer ses pensées et émotions. Lorsqu’on parle de nature, il est souvent question d’interdictions, de contraintes, c’est loin, il n’y a rien… A la Skol Louarn on entend là une opportunité d’y créer des choses qui nous manque, dans le respect de la loi évidemment. Randonner, bivouaquer, observer, ramasser, cueillir, découvrir, fabriquer, apprendre et ne jamais cesser d’apprendre en y faisant des choses.
3- Les compétences à amener au public accueilli (objectifs)
a] Développer les différentes formes d’autonomie (développement personnel / individuel)
Que ce soit pour l’adulte qui cherche à monter en compétence ou le jeune qui cherche à acquérir ou perfectionner sa capacité à déterminer par lui-même les normes auxquelles il souhaite obéir (définition étymologique de l’autonomie). Nous souhaitons développer les formes d’autonomie pour notre public accueilli, mais cela n’est qu’un but en soi, on veut tous que nos jeunes aient de l’autonomie mais on ne s’attache pas assez à en comprendre les différentes formes. Pour parvenir à véritablement les rendre capables de résoudre des situations par eux-mêmes, de choisir, d’essayer, de prendre des initiatives, donner du sens à leur apprentissage, il faut bien en comprendre la portée. C’est long, peut-être, mais c’est notre projet éducatif alors on se permet, voici les 7 formes reconnues d’autonomies que nous développerons chez chaque participant à nos activités (#Hervé Caudron) :
- L’autonomie affective : chacun doit apprendre à se dégager de l’aide permanente d’autrui (l’adulte entre autre)
- L’autonomie corporelle : prendre conscience de ses possibilités / capacités physiques, apprendre et contrôler ses gestes quotidiens (pour nous : utiliser les outils, gérer son hygiène, se faire à manger…)
- L’autonomie matérielle : gérer son matériel personnel et collectif, savoir quand et où le prendre, le ranger, en prendre soin
- L’autonomie spatio-temporelle : se situer dans l’espace et le temps, comprendre les limites des zones où aller, ne pas aller ; comprendre le temps alloué et le respecter (soft skills : ponctualité, respect du timing) ; s’orienter en nature et comprendre les chemins qu’on peut et qu’on ne DOIT PAS prendre (danger, interdit, pertinence)
- L’autonomie langagière : oser prendre la parole, s’avoir s’exprimer, savoir quand se taire, quand être poli en réduisant son expression (donc gérer ses émotions en société)
- L’autonomie dans le travail : anticiper ce qu’on va faire, se projeter, gérer son temps, modifier une méthode qui ne permettra pas d’atteindre son objectif, organiser un projet et confier (et donc savoir recevoir) les responsabilités
- L’autonomie intellectuelle : aimer et savoir se poser des questions, s’informer, mobiliser ses connaissances, avoir envie d’en apprendre plus, valoriser les questions et la curiosité, prendre le temps d’expliquer quand on sait
- L’autonomie morale : se référer à des règles ayant une valeur, au lieu de se soumettre simplement à autrui (entre autre l’adulte) ou au groupe, avoir le courage de défendre ses opinions tout en sachant accueillir celles des autres sans vouloir les contrôler, les écraser, les forcer à changer d’avis.
Ce sont toutes ces formes que nous mettrons en avant auprès des adultes comme des jeunes accueillis sur nos activités. Cela en fait du travail non ? Et pourtant, entre les savoirs-techniques, les savoirs, les savoirs-faire et finalement les savoirs-être, nous ne lâcherons rien. Une insulte sera reprise et analysée, un renoncement ne sera jamais pris à la légère et sera débriefé, un échec sera toujours décomposé et reproposé comme défi à relever, un poème ou un conte ou un haïku sera lu de temps à autre pour développer aussi l’intellectuel ou le culturel. Finalement, faire évoluer sur les formes d’autonomie permettra à tous de réfléchir à son bien-être et à la place qu’il donne à son développement personnel par rapport à son temps et ses activités.
b] Le vivre ensemble et le vivre ensemble dans la nature
Chaque adulte ou enfant accueilli dans nos activités se verra proposé une intégration pleine et entière au sein du groupe de participants, qu’ils soient de son âge ou non. Parce qu’on n’arrête jamais d’apprendre et de se remettre en question, ce sera une belle opportunité de travailler sur sa sociabilité. On vit à une époque de haute technologie et pourtant les gens ont rarement été aussi seuls. Plus besoin de sortir faire ses courses si on est livrés à la maison, plus besoin d’aller au cinéma ou en bibliothèque on a tout sur nos téléphones, tablettes, ordinateurs. Plus envie de faire des efforts à développer des relations aux autres, on peut s’envoyer un SMS ou un message vocal. Cela pousse à l’enfermement, au manque d’activités physiques et sociales. Il en faut un peu évidemment pour se retrouver face à soi-même, il faut prendre le temps de faire la place en soi pour pouvoir accueillir l’autre, c’est la définition de la spiritualité.
Mais c’est élan solitaire est un prémisse aux retrouvailles et ne doit pas devenir un mode de vie, l’humain est un animal social et grégaire. Nous serons donc attentifs à ce que chacun ait une place, qu’il la prenne ou qu’on lui tende, et puisse se confronter à la différence, d’exploiter les richesses de la diversité (sociale, géographique, d’âge…). Il sera permis à chacun d’expérimenter la démocratie et la citoyenneté utile et le tout dans un cadre naturel qui mettra au défi notre capacité à vivre ensemble (pas de chambres individuelles, pas d’eau courante, pas d’électricité, des activités majoritairement de groupe). Partager, coopérer, aider, montrer, s’ouvrir et recevoir, seront les maîtres mots.
c] La rusticité
Il nous semble primordial d’orienter notre public, accueilli pour 3h, pour une journée, pour 2 ou 3 jours, à s’interroger sur la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi mais aussi à tous les acteurs de la nature, du tourisme responsable. Afin de s’ancrer de nouveau dans notre nature, plutôt que de vivre « hors-sol » et déconnecté des réalités environnementales, il sera bon que chacun prenne l’opportunité de cette visite chez nous pour réfléchir à ses besoins réels. Nous ne prônons pas de tous vivre en roulotte ou de tous construire des toilettes sèches dans nos habitations. Si nous sommes profondément attaché à la nature, nous ne sommes pas spécialement politisés ou étiquetés écolos. Nous sommes juste désireux de créer chez notre public ce questionnement sur « avons-nous vraiment besoin de tout cela ? ».
Il sera donc proposé pendant nos actions : un retour évident à la terre (toucher, humer, manger, observer) ; un éloge passif mais conscient à la lenteur (ce n’est pas une fatalité) ; un crochet vers une forme de minimalisme matériel (faire le tri dans ce qu’on utilise jamais, ce qu’on utilise rarement, ce qu’on utilise tout le temps) ; la déconnexion (sans pour autant arrêter de faire des photos, d’emmagasiner des souvenirs virtuels si l’on veut) ; finalement de parvenir à garder la mesure, ou l’équilibre, entre ce qui nous fait envie et ce dont on a besoin (pas besoin de tous vivre sans électricité dans des igloos à l’année).
Pour les jeunes parfois la forme sera d’une simplicité évidente, nous serons assis par terre, dans l’herbe, dans l’humus, dans la terre. Vous verrez qu’au début ils seront tous soupçonneux de ces surfaces dites « sales », puis après 3-4 heures, après 2 jours… ils se rouleront dedans comme jaja. C’est d’ailleurs un de nos critères observables de réussite du développement de la rusticité chez l’enfant (ça et le fait que quand on lui dit de s’asseoir, il attrape une bûche qui traine, se pose dessus, attrape un gros caillou, croise ses pieds dessus « je suis bien là »).
d] Habiter autrement la planète
Et oui, on n’est pas formateur scout pendant 9 ans et puis d’un coup on oublie tout. Il convient de valoriser cette action des scouts (SGDF) qui a développé cet outil auquel nous souscrivons dans une certaine mesure. C’est un mélange entre une prise de conscience d’une société avec un mode de vie non-viable ou plutôt non-durable, et un ensemble de compétences à développer chez chacun pour intégrer un changement de comportement (de consommateur mais aussi en tant que modèle familial ou social).
HALP repose sur un outil composé de 7 grands domaines qui couvrent les aspects de la vie en nature : les transports, l’alimentation, les déchets, la santé, l’environnement, les échanges et relations sociales ainsi qu’une forme de spiritualité (qui rappelons-le, consiste à faire de la place en soi pour accueillir l’autre, ce n’est pas exclusivement religieux mais plutôt un questionnement sur le sens de sa vie, pourquoi, comment…). Des exemples ici.
Concrètement ? Nous inviterons notre public à réfléchir à l’impact humain sur l’environnement et les petits gestes (de colibri, pour ceux qui ont la référence) qui peuvent faire de grandes différences. C’est par exemple réfléchir aux emballages qu’on amène en forêt pour diminuer notre emport (taille, poids) et réduire nos déchets. C’est par exemple consommer plus localement, de saison, favoriser les circuits courts, adapter les quantités par personne selon les besoins de chacun(et quitte à froisser certains intendants scouts, cela ne veut pas dire mal manger, ou devoir se priver « pour que chacun en ait », ou forcer à ne pas manger de viande ou autre, cela veut dire manger à sa faim, un repas équilibré, dans le respect du régime alimentaire de chacun). C’est par exemple développer dans un groupe des objectifs de développement durable tenables en nature. C’est par exemple avoir le bon produit vaisselle qui ne va pas marquer ou stériliser le sol et la végétation pendant 3 ans. C’est par exemple faire du covoiturage pour éviter de prendre 4 voitures pour 4 personnes sur le même trajet (de toute façon on n’a pas la place de se garer sur notre terrain hé hé).
e] Faire monter le public en compétences individuelles
-Gestion de la prise de risque : ainsi que le disait Louis Espinassous, « Laissez les grimper aux arbres », cela implique que pour les enfants (et les adultes…) comprennent leurs limites et celles de leur environnement il est important qu’ils expérimentent dans un cadre sécurisé. Savoir que l’on peut faire cela, que l’on peut faire ceci mais que ça peut être dangereux, qu’on ne doit pas faire cela car c’est trop risqué (quel bénéfice ? quelle perte en cas d’accident ?), est vital pour aider les jeunes à devenir des adultes capables et responsables.
-Confiance en, et maîtrise de soi : essayer quelque chose de nouveau et réussir, quel bonheur cela procure ! Les participants à nos activités auront l’opportunité d’essayer, et nous les accompagnerons vers la réussite. A condition que l’activité soit adaptée à leur capacité, ils pourront y arriver et développer des sentiments de bien-être qui forgent les grandes réussites de demain, la confiance en soi, la maîtrise de soi, l’espérance dans le succès.
-Concentration : prendre 1h30 pour monter un abri, réfléchir aux problèmes de confort au sol, anticiper la forme pour nettoyer le sol des branches et cailloux, comprendre d’où vient le vent et où monter le mur principal de l’abri, prévoir l’écoulement de l’eau en cas de pluie. Mais aussi tailler du bois pour manger avec, même si cela prend 2h, tailler juste un piquet pour améliorer l’angle d’un tarp avec une ficelle. On est en extérieur mais tout cela créer beaucoup de cogitations à l’intérieur et aidera les plus dissipés à se focaliser sur un problème à la fois, être calme et concentré.
-Connaissance générale de la nature : en étudiant la nature DANS la nature on offrira une chance unique à nos participants d’apprendre du contenu dédié à leur passion. Que ce soit sur les 4 grands taxons (botanique, entomologie, ornithologie, mammalogie) ou des choses plus légères comme gérer les couches isolantes de vêtements, charger son sac, comprendre les températures sur les duvets, anticiper la météo… cela fera des participants de vrais pratiquants de la nature, pour ne pas dire des baroudeurs.
PROJET PÉDAGOGIQUE
Le but du projet pédagogique est d’appliquer les orientations et valeurs défendues par le projet éducatif et de l’appliquer à une situation donnée, par exemple une colonie, un mini-camp, une forest school mensuelle. Il présente les caractéristiques de l’accueil qui sera donné au public, il s’écrit collectivement quand on a une équipe d’animation (nous… Renan va le faire en tête à tête avec un feu de camp et une forêt). Il précise le cadre des interventions qui seront faites en liant l’éducatif (théorie) et le terrain (pratique), en donnant des horaires, des objectifs précis, des actions permettant de les dérouler, des moyens à dispo ou à acquérir pour les mettre en place, enfin des critères d’évaluation pour vérifier l’avancée du projet en phase de préparation ou sa complétition une fois réalisé (avons-nous réussi ce que nous visions).
Le projet pédagogique étant adapté à chaque projet précis (selon l’âge, le lieu, les conditions d’accueil, la durée, les moyens, l’équipe…) il n’est pas pertinent pour nous d’en rédiger un. Mais sachez que si on le devait, dedans on lirait 400 fois « nature », « faire soi-même », « construire, fabriquer », « se faire des copains », « … avec son couteau à la taille… », « autour du feu ». L’idée est de ne jamais oublier que c’est les participants qui sont les acteurs, on valorise les moments où ils parlent, où ils font, où ils sont dans l’action et on minore (on essaie) les temps où ils sont statiques à écouter (surtout les jeunes, les adultes sont souvent demandeurs d’explications détaillées, quand il faut il faut).